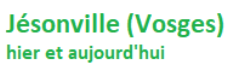PILON Marc son histoire
- Détails
- Catégorie : Généalogie
- Publié le samedi 30 décembre 2023 22:36
- Écrit par Daniel AUDINOT
- Affichages : 54
Marc PILON et ses aïeux
histoire(s) familiale(s
par Arnaud GRANDCLERC petit-fils
2015
Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir.
Archiduc Otto d'Habsbourg-Lorraine
Point de départ
à 38 ans à 59 ans
Mon grand-père, Marc PILON, est né à Jésonville (Vosges) le 4 ou le 5 mars 1911 (il en riait, l’armée s’étant visiblement trompée sur son livret militaire[1]).
Maçon, il a été fortement marqué par la seconde guerre mondiale, où il a été prisonnier en Prusse Orientale. Mais il ne parlait pas ou peu, ce qui m’a incité à chercher.
J’ai aussi voulu mieux comprendre tout l’arrière plan familial, pour l’essentiel centré sur le village de Jésonville (il descend d’une lignée d’agriculteurs de Ville sur Illon installés à Jésonville en 1729, faisant des Pilon l’une des plus vieilles familles du village). J’ai découvert des tailleurs de pierre puis maçons, des gens profondément marqués par les décès prématurés…
Ancêtres lointains
Les PILON ne sont a priori pas originaires des Vosges : on les retrouve successivement dans l’ouest de la France, sur 2 foyers de peuplement importants :
· au départ (en tous cas dès 1520), on sait qu’ils sont implantés à St Méloir des Ondes (à côté de St Malo[2] et de Cancale, actuelle Ile et Vilaine)
· 50 ans plus tard, on retrouve un second foyer à Azé et Mazangé (à côté de Vendôme, actuel Loir et Cher, à 50 km à l’Est du Mans[3]). Les PILON y auront une nombreuse descendance. Aujourd’hui, le 1er département de naissance des PILON est d’ailleurs encore le Loir et Cher[4] (en revanche, on n’en retrouve plus en Ile et Vilaine).
Entre ces 2 pôles, on retrouve également quelques PILON dans la Sarthe.
 Comme on le voit sur la carte page suivante, il semble qu’il y ait eu assez un mouvement vers l’Est, vers Paris notamment[5]. C’est par exemple le cas de Germain PILON, célèbre sculpteur qui travaillera pour la Cour de France, dès 1558. Son père, André, est originaire de la région du Mans, où il nait vers 1500 (c’est donc le plus ancien PILON connu). Scuplteur[6], il forme son fils Germain, né à Loué dans la Sarthe (ou à Paris) vers 1515 (ou 1525). Germain est installé à Paris, près de la Cour, vers 1540.
Comme on le voit sur la carte page suivante, il semble qu’il y ait eu assez un mouvement vers l’Est, vers Paris notamment[5]. C’est par exemple le cas de Germain PILON, célèbre sculpteur qui travaillera pour la Cour de France, dès 1558. Son père, André, est originaire de la région du Mans, où il nait vers 1500 (c’est donc le plus ancien PILON connu). Scuplteur[6], il forme son fils Germain, né à Loué dans la Sarthe (ou à Paris) vers 1515 (ou 1525). Germain est installé à Paris, près de la Cour, vers 1540.
[1] une naissance en 1518 à St Malo. Les 1ères naissances à St Méloir sont notées en 1548
[1]mariage au Rouilly (aujourd’hui Rahart) en 1570, naissances nombreuses à Azé dès1570, à Mazangé dès 1580. Quelques naissances sporadiques (St Ouen en 1610, Danzé en 1620, Ambloy en 1645, Champigny en Beauce en1650, Thoré la Rochette en1650)
[1] 111 naissances dans le Loir et Cher entre 1891 et 1915. 1 Pilon sur 6 est né dans ce département à cette époque. 2ème département : la Sarthe. Les Vosges viennent en 8ème position avec 22 naissances sur la période. On notera que le nom de famille PILON n’est ni rare ni en régression : 689 naissances entre 1891 et 1915, 877 entre 1916 et 1940, 1314 entre 1941 et 1965, 1213 entre 1965 et 1990.
[1]Au-delà de St Méloir (35), de Mazangé (41), de Paris (75) et de Metz (57), on note d’autres naissances, à Cancale (35) en 1548, à Chemault (45) en 1559, à Achères (78) en 1565, et au Rouilly (41) en 1570
[1]Aucune des créations d'André Pilon n'a été conservée, de sorte que l'on ne peut apprécier son style. Certaines commandes révèlent toutefois sa prédilection pour les statues en bois peint et pour la terre cuite, ce qui laisse supposer qu'il se rattachait au monde des formes médiévales
D’autres PILON, dans le même temps, s’installent (ou sont déjà installés) dans le nord de la Lorraine.
Avant 1550, on ne retrouve pas de PILON dans l’Est de la France. Le fait que la Guerre de Trente Ans ait ravagé la Lorraine au milieu du 16ème siècle, tué la moitié de ses habitants et anéanti les registres paroissiaux, ne nous rend pas les choses faciles. Difficile donc d’avoir une vision exhaustive avant 1650. Mais on peut penser quand même que si plusieurs ménages PILON y vivaient, on retrouverait la trace de leurs descendants.
Nous ne retrouvons pas non plus de PILON dans les Vosges avant 1620/1650. Les 1ers sont probablement installés autour d’Epinal vers 1600/1650 : Barbe PILON, née avant 1620, épouse ainsi, avant 1639, Claude GERARD, Conseiller de la Ville d’Epinal, Prévôt du Chapitre.
On retrouve d’autres traces un peu plus tôt en Lorraine vers 1560, mais la filiation est incertaine. Il s’agit de juifs présents à Metz. Ainsi, Suzanne PILON, née probablement vers 1630, se marie le 15 janvier 1651 à Metz, avec Jean BEAUDESSON (1629-1677). Nous se savons pas si elle était d’origine juive, mais leurs enfants semblent l’être (Abraham BEAUDESSON nait en 1652, Isaac en 1655, Jean BEAUDESSON en 1658, Samuel en 1660, David en 1664,et Louis en 1667
Pour remettre dans le contexte, en 1552, les Trois-Évêchés (Metz, Toul et Verdun) sont envahis par le roi de France. Il semble y avoir alors très peu de Juifs en Lorraine, mais une garnison française forte de plusieurs milliers d'hommes est installée à Metz, et les autorités françaises permettent, à des Juifs de s'établir en tant que banquiers à Metz. On y retrouve une autre famille juive[7] nommée PILON. Etaient-ils déjà présents avant 1557 comme le suggère le mariage entre Suzanne PILON et Jean BEAUDESSON ? Venait-elle de Paris ou des terres françaises de l’Ouest du Royaume ? Difficile à dire.
Josué PILON[8], né à Metz vers 1560, y aura 9 enfants[9], tous nés entre 1590 et 1607. Il est assuré qu’une partie de cette famille a émigrée au Pays Bas après 1620[10], mais il est possible que certains soient restés en Lorraine. Nous ne pouvons donc pas exclure que notre branche puisse descendre de ces PILON venus à Metz entre 1567 et 1590.
Ce qui est en revanche certain, c’est que les traces que l’on trouve après n’évoquent plus de lien avec le judaïsme[11]. En Moselle, on recense ainsi un Charles François PILON, né en 1650 à Marsal et qui se marie avec Anne COUPETTE (ils auront un enfant en 1679, Charles Francois PILON). De même, on note une Suzanne PILON, née vers 1663 à Vry, à l’Est de Metz, et qui s’y marie en 1688.
Un peu plus au sud, quelques années plus tôt, on retrouve déjà un Romain PILON, Maitre jardinier du duc de LORRAINE, qui se marie le 3 juillet 1622 à Nancy avec Jeanne Suzanne GABRIEL.
Dans les Vosges, les premières traces concernent Barbe PILON, née avant 1620 (mais nous ne savons pas où précisément) et qui épouse le Prévôt du Chapitre d’Epinal[12]. La famille restera implantée dans les Vosges[13].
A l’époque, les temps sont très troublés. En pleine Guerre de Trente Ans, la Lorraine est foulée et refoulée par les gens du guerre. Les populations fuient ou sont massacrée (la moitié de la population lorraine disparaît entre 1630 et 1650). Quoi qu’il en soit, les familles ont du bouger.
Un autre PILON, Claude, né avant 1650, et marié avec Nicole MANGIN, s’installe ainsi probablement près d’Epinal. Leurs 3 filles se marient en effet à Florémont (1688), Darnieulles (1698) et Epinal (1700), ne transmettant plus leur patronyme.
On retrouve du reste un autre Claude[14], né lui un peu plus tard (vers 1660), dans un lieu également inconnu, qui s’installe à Gigney, un peu à l’ouest d’Epinal. Il aura une nombreuse descendance. Ses enfants se marient aux alentours, à Darnieulles, Uxegney, Racécourt[15]. On note également le mariage d’une Marguerite PILON à Gigney en 1698 (elle est donc née vers 1680).
Ancêtres en ligne directe
Quoi qu’il en soit, à partir de la fin du 17ème siècle, la filiation en ligne directe nous est connue. On remonte ainsi sur 11 générations[16] jusqu’à Nicolas PILON, né vers 1670 à Ville sur Illon et marié vers 1700 avec Marguerite FRANCOIS, elle-même de Ville sur Illon.
Après des fiançailles le 24 avril 1729[17], son 3ème fils[18], François PILON, né à Ville sur Illon en 1704, se marie à Jésonville le 17 mai avec une fille du village, Marie BUSIOT[19]. Ce sera le début de la branche PILON installée à Jésonville (à l’époque « Gésonville » ou « Gézonville »[20]) dont nous descendons.
[1] de mon fils Nicolas GRANDCLERC à son aïeul Nicolas PILON
[1] c’est-à-dire l’année où Louis XV impose son beau père, Stanislas Leszczyński,, comme Duc de Lorraine, le dernier Duc, François III se voyant proposer en échange le royaume de Toscane (ce qu’il accepte malheureusement)
[1] les 2 premiers se marient aux Ableuvenettes et à Charmois l’Orgueilleux, où ils feront souche. 2 autres enfants suivent après François mais nous ne savons pas s’ils auront une descendance (la lignée de Ville sur Illon s’éteint par la suite)
[1] Ses parents et grands parents, dont on ne sait où ils sont nés, sont tous décédés à Jésonville. Ils sont présents à Jésonville depuis au moins 1695 (avec les Remy, Henri, Noël, Poirot, Ferry, les Busiot composent le petit noyau d’habitants du village post Guerre de Cent Ans
[1] Gisonville en 1290, Gesonville et Jezonville en 1297, Jesonville en 1591, Gezonville en 1724, etc., de Gisonis villa
Ce mariage intervient à un moment très particulier : il ne faut pas l’imaginer avec nos yeux d’aujourd’hui, dans l’environnement actuel. La région a en effet été totalement dévastée entre 1630 et 1660 par la Guerre de Trente Ans. La Lorraine, occupée 3 fois par la France, a été foulée par toutes sortes de gens de guerre. Elle a perdu plus de 60% de sa population.
Localement, la situation est terrible. En 1638, le duc de Lorraine ordonne à ses troupes d’abandonner Darney au Roi de France, lequel rase la forteresse (il fait démanteler les fortifications, ne laissant que 2 portes). A Dommartin, le curé écrira sur son missel que l’on mange chiens, chats, cuirs et même chair humaine... Les villages sont désertés, les fermes abandonnées, de sorte qu’après les hostilités, en 1657, Darney ne compte plus que 8 habitants (contre 200 avant la guerre), Dombasle aucun, Dommartin 4…
Déjà probablement peu peuplé, Jésonville est profondément marqué par les ravages de la guerre. Le village ne compte plus qu’une ou deux familles en 1657 (6 habitants).
Pendant 70 ans, le village enregistre très peu de naissances et peine à se redresser. En 1710 (soit 19 ans avant le mariage de François PILON et de Marie BUSIOT), Jésonville ne compte encore que 19 habitants. Il en compte 23 seize ans plus tard, en 1726[21].
Les Ducs de Lorraine cherchant à repeupler ces « déserts », c’est dans ce contexte difficile qu’arrive François PILON, venant de 25 kilomètres plus à l’Est, peut-être attiré par quelque facilité accordée aux jeunes mariés ou cherchant simplement quelques terres à exploiter.
Il se marie donc en 1729 (cela en fait au passage la ou l’une des plus anciennes familles du village de Jésonville, puisque des descendants y vivent encore 285 ans plus tard). François et Marie ont 4 enfants en 5 ans. Naît d’abord en 1730 une fille, Marie Catherine, puis en 1732 Anne Françoise (qui décèdera à 17 ans). Viennent ensuite peut-être une autre fille (Marie) et un garçon en 1735, Christophe, qui est notre ancêtre (à l’époque, les français occupent définitivement la Lorraine).
Malheureusement, signe des temps d’alors très difficiles, 10 mois plus tard, sa mère, Marie BUSIOT, décède. Elle a 25 ans… Christophe se remarie assez vite (probablement en 1737), avec Agnès COLAS, qui a alors 33 ans. 2 petites Marguerite naissent en 1738 et 1747 mais décèdent en bas âge (à 14 mois et 5 semaines…).
La 1ère fille, Marie, épouse un agriculteur de Jésonville en 1753, à 23 ans. Le village reste encore un hameau : en 1764, il compte 8 « feux », soit une quarantaine de personnes.
Christophe reste beaucoup plus longtemps avec son père : il se marie à 35 ans avec une fille de Senonges, Marianne MATTE[22]. Ils s’installent à Jésonville, où ils sont « laboureurs ». La Lorraine est devenue française en 1766. En 1767, le Roi de France confirme les habitants de Jésonville dans leurs droits d’affouage, marronnage et vaine pâture dans la forêt de St.Christophe…
Christophe et Marianne vont avoir une descendance nombreuse (8 ou 9 enfants) :
- Agnès (née en 1771), qui se mariera à Jésonville, puis une seconde fois, au décès de son mari, à un meunier de Gruey, garde des forêts royales de Grandrupt
- Jean Nicolas (1775)
- Nicolas[23] (vers 1776), cultivateur à Jésonville
- François (1777), cultivateur à Jésonville puis tuilier à Harol (il se remariera à Gorhey)
- Marie (née en 1779 à Jésonville)[24], cultivatrice
- Jean-Baptiste, notre ancêtre, né en1781 à Jésonville
- Catherine (1784), cultivatrice à Jésonville
- Marie Rose (1789), cultivatrice à Jésonville
- Joseph[25] (1789), manouvrier puis agriculteur à Jésonville.
Le père, Christophe, décède en avril 1790. Il a 54 ans et laisse 8 ou 9 enfants, de 1 à 19 ans, dont notre ancêtre, Jean-Baptiste, qui a 9 ans.
Difficile de dire comment les choses se passent, mais il est probable qu’ils reprennent tant bien que mal l’exploitation (les 4 garçons seront ultérieurement cultivateurs à Jésonville).
Jean-Baptiste se marie en 1808 à Jésonville (il a 27 ans) avec Anne BOULAY, fille du percepteur de la Région de Lerrain (qui sera également maire de la commune après la Révolution) (Voir Généalogie des Boulay). Ils habitent la maison Philibeaux actuelle. Leurs 2 premiers enfants, nés en 1808 et 1811, décèdent tous en bas âge[26]. Une fille (Marie Joséphine) naît en 1812 (cultivatrice, elle se mariera avec un tailleur de pierres de Jésonville. Ils habitent la maison Philibeaux). Un fils, Jean-Baptiste (notre aïeul en ligne directe), naît à Jésonville en 1813.
Leur père meurt prématurément en 1815, à l’âge de 34 ans, laissant deux enfants de 2 et 3 ans. La situation doit être très difficile puisque son épouse décède quant à elle 4 ans plus tard, à 37 ans.
Les deux enfants sont donc orphelins à l’âge de 6 et 7 ans. Mais ils restent à Jésonville, où ils sont probablement pris en charge par des proches (peut-être la grand-mère ou plus probablement un des oncles, Nicolas ou Joseph).
Il doit y avoir à ce moment une rupture profonde. Il est en effet marquant de noter que, plus tard, Marie Joséphine et Jean Baptiste ne seront pas agriculteurs comme leurs parents, mais respectivement mariée à un tailleur de pierre (Jean Luc BEGRAND) et tailleur de pierre. Une longue tradition de tailleurs de pierre, de carriers ou de maçons débute ainsi vers 1840, à un moment où démarre une phase de reconstruction des maisons du village (coïncidant avec le maximum de population[27]).
La situation dans la région semble tout de même difficile dans toutes les familles. Ainsi, une épidémie de choléra sévit à Darney et aux alentours en 1832, 1834 et 1839, puis entre 1849 et 1854...
Jean-Baptiste (qui est donc tailleur de pierre), se marie à Bonvillet en 1841 avec Julie Hué. Il semble qu’en 1845 il ait un projet de construction d’une tuilerie à Nonville[28]. Toutefois, ils resteront à Jésonville (ils habitent une maison démolie à côté de la maison Clévy actuelle –anciennement SCHAD). Julie et Jean-Baptiste vont avoir 4 enfants :
- Léon « Stanis[29] » (1842), notre aïeul, qui sera tailleur de pierre à Jésonville
- Joseph Alfred (1847), également tailleur de pierre à Jésonville, décédé à l’âge de 21 ans
- Marie Joséphine (1848), décédée à 1 jour
- Joseph (1851), tailleur de pierre à Jésonville, décédé à l’âge de 17 ans
A l’époque, à Dombasle, Jésonville, Lerrain et Senonges, garçons et filles font à l'école, de 5h à 20h, de la broderie et de la dentelle pour suppléer à la pauvreté des parents. Malgré une plainte de l'académie, les poursuites seront abandonnées, le travail des enfants étant admis comme un mal nécessaire).
Seul Stanis va pouvoir construire une famille, ses frères et sœur décédant prématurément. Cela explique le fait que les familles[30] PILON se réduisent fortement à la fin du 19ème siècle à Jésonville.
Stanis se marie au village en 1870 avec Louise Gaudé. Lui est tailleur de pierres, elle dentellière puis épicière (elle le restera très longtemps). Ils habitent dans la maison des parents de Stanis (maison démolie à côté de la maison Clévy). De leur union naissent 3 enfants[31] :
- Louis Joseph[32] (1870), qui sera carrier, tailleur de pierres. Avec son épouse Marie Louise Franquin, ils tiendront un café[33]
- Marie Joséphine (1875)
- Jules Joseph (1878), mon arrière grand-père…
La jeunesse de Marc PILON
Jules se marie avec Marie Renée JEANROY à Jésonville en 1910. Née en 1887, elle est brodeuse. Lui est carrier[34]. Son père, Stanis est déjà décédé depuis de nombreuses années (il meurt en 1892, à 50 ans). Jules vit avec sa mère, Louise Gaudé, qui a alors 65 ans. Elle tient une épicerie/café dans le village (probablement l’actuelle maison CLEVY, au 111 rue du Général Leclerc, même si l’on ne peut écarter la maison Redoutey, 6 rue du Vial, où un fils habitera plus tard).
2 éléments se conjuguent pour faciliter l’union : ils habitent pas très loin les uns des autres (les JEANROY probablement au 65 de la rue du Général Leclerc[35], les PILON au 111). Surtout, le père de la mariée, Jean-Baptiste JEANROY, exerce un métier proche de celui de carrier : il est maçon.
Il est possible que Jules et Marie viennent habiter dans la maison PILON actuelle, rue du Vial, au moment de leur mariage. On ne sait pas précisément qui habite là auparavant. Il pourrait s’agir d’un de nos ancêtres côté paternel Constant GRANDCLERC (cantonnier, né en 1843 à Dombasle), dont on sait qu’il habite à proximité en 1906 (c’est le grand-père de Jeanne « GRANDCLAIR »…). Mais il probable qu’il ait plutôt habité dans l’actuelle « maison du patrimoine » de Jésonville. Peut-être qu’il s’agit plutôt d’une maison habitée par Pélagie et Joséphine LOIELLET, 73 et 71 ans, dentellières (la maison pouvait être « disponible » en 1910). A moins que ce ne soit déjà des PILON…
Un peu plus loin[36] habite un frère de Jules, Louis PILON, marié à Marie Louise FRANQUIN en 1899.
Quoi qu’il en soit, Jules et Marie vivent dans la maison PILON actuelle, 145 rue du Vial. Ils vivent petitement, avec 2 vaches.
Mon grand-père, Marc, naît à Jésonville le 4 mars 1911 « à 2h du soir » mais n’est déclaré à l’Etat Civil que le lendemain, le 5 à 11h, ce qui créera quelques malentendus (sur son livret militaire, la date mentionnée est le 5/03/1911 et cette date sera souvent retranscrite). Son père a-t-il fêté l’évènement[37] ou l’agent de l’Etat Civil (le maire ou le secrétaire de mairie, qui était l’instituteur) n’était-il tout simplement pas disponible ?
L’année suivant naît un petit frère, Roger Gilbert Emile, qui décède à un mois.
Puis vient la guerre. De la petite enfance de Marc, nous ne savons rien. Son père, qui a 36 ans en 1914, est incorporé (Marie obtient le 21 août 1914 une aide de la mairie). Il est probable qu’il participe à la totalité de la Première Guerre Mondiale[38]. Marc vit donc sans doute de l’âge de 3 ans à 7 ans seul avec sa mère et peut-être avec l’une ou l’autre de ses 2 grands-mères. Marc ne connaîtra aucun de ses 2 grands-pères[39] mais ses 2 grands-mères[40] sont encore vivantes. Louise Gaudé, veuve PILON, qui est épicière et ne décède qu’en 1925. Peut-être que Marie et son fils Marc habitent avec elle, même s’il serait logique que Marie vive plutôt avec sa mère, Eugénie THYRIET (celle-ci est encore de ce monde mais vit dans des conditions précaires[41]).
On doit sans doute se serrer les coudes. Si le père est mobilisé, presque plus aucun revenu ne vient subvenir aux besoins du foyer…
Marc va à l’école communale et peut se montrer facétieux. Il raconte par exemple s’être caché dans le marronnier situé à l’angle du chemin du Bois, à côté de sa maison, pour lancer des marrons sur son institutrice, qui venait de La Craque en vélo. Etait-il bon élève ? Le registre des matricules militaires nous apprend simplement que son degré d’instruction était de niveau 3 : sait lire, écrire et compter. A priori, pas de Certificat d’Etude donc.
En 1923, Marc a 12 ans. C’est à ce moment là qu’arrive un petit frère, Henri.
Marc devient sans doute assez vite « arpète », apprenti maçon, comme son grand-père maternel, qu’il n’a pas connu (Jean-Baptiste JEANROY décède en 1908). Où apprend t-il le métier de maçon ? Il est possible qu’il débute tout simplement avec son père, Jules, qui a 45 ans (en 1927 il est déclaré comme maçon et non plus comme carrier), à moins que ce soit avec son oncle maternel, Adrien JEANROY, qui habite en face et est entrepreneur de maçonnerie (en 1920, celui-ci réalise divers travaux pour la commune (démolition d’une maison communale et réfection du mûr du cimetière).
je crois me souvenir que c’est ce que m’a dit mon grand-père
[1] on notera qu’aucun enfant ne naît pendant la guerre
[1] Stanis PILON meurt en 1892 et Jean-Baptiste JEANROY en 1908
[1] on ne sait quand est décédée Eugénie THYRIET, l’épouse de Jean-Baptiste JEANROY
[1] le14 février 1914, elle fait une demande de soutien de famille à la commune, en faveur de son fils Marie Adrien qui doit être incorporé en octobre 1914. Le Conseil Municipal, vu sa « situation peu aisée » donne un avis favorable à la demande.
A peine majeur (à 21 ans), Marc est incorporé le 15 avril 1932 au 23ème régiment de tirailleurs algériens. Il arrive à Toul le 21 avril comme 2ème classe. Selon le registre des matricules militaires, il est alors maçon. Il est décrit comme ayant des cheveux châtains, des yeux gris, un front découvert (déjà !), un nez moyen et un visage rond. Il mesure 1,62 m.
Il reste à l’armée 11 mois et demi. En avril 1933, il est donc de retour à Jésonville. Il reprend alors son travail de maçon. C’est probablement à ce moment là qu’il commence à travailler à une bonne vingtaine de kilomètres, à Darnieulles[42]. Il s’y rend chaque jour en moto (il aura d’ailleurs un accident grave avant guerre).
Cela dure pendant presque 2 années. Mais le 11 janvier 1935, Marc est convoqué pour une période d’exercices militaires de 21 jours au 41ème régiment mixte d’infanterie coloniale, près de Sarreguemines (probablement à Sarralbe ou Puttelange au Lac).
Malheureusement, les 21 jours vont se muer doucement en presque 4 ans, en vertu de l’article 49 de la loi du 31/03/1928 sur les dispenses d’ajournement en cas de force majeure. Cette loi prévoit en effet (art. 52) d'affecter à des corps spéciaux les hommes de la deuxième réserve " dont l'activité professionnelle est indispensable (...) à la satisfaction des besoins de l'armée ". Autrement dit, pour construire la ligne Maginot, il faut des maçons…
Marc rentre à Jésonville le 7/10/1938, mais pour une assez courte durée. Moins d’un an après, la guerre éclate et il est rappelé le 25 août 1939 au 51ème régiment mixte d’infanterie coloniale (le 51ème RMIC est formé le 22 août 1939 à partir des éléments du 1er bataillon du 41ème RMIC, régiment en garnison à Sarralbe pour couvrir la ligne Maginot).
Le deuxième bataillon du 51ème RMIC auquel appartient Marc PILON participe début septembre 1939 au soutien des détachements de la IVème Armée au Sud de Forbach lors de « l’ Opération Sarre ». Fin septembre 1939, le II/51ème RMIC revient sur ses positions à Sarralbe et prend alors part avec l’ensemble du régiment aux travaux de fortification de la position. Ces aménagements se poursuivent sans relâche durant toute la « Drôle de Guerre », en dépit d’une météo défavorable (période de froid intense).
Un drame le ramène momentanément à Jésonville. En effet, ses parents décèdent tous les 2 brutalement. Jules tombe du grenier (probablement au fond de la grange, près de la cave). Peut-être d’une échelle. Il est alité dans la chambre, mourrant. Le 28 mars 1940, Marie décède brutalement d’une attaque cardiaque dans la cuisine (pièce contiguë à la chambre). Pour ne pas affecter Jules, qui est mourant, elle est transportée en face, chez les JEANROY (dans la maison de son frère Adrien). Jules meurt 3 jours plus tard, le 31 mars 1940, sans savoir que sa femme est décédée.
Marc a sans doute été rappelé du front entre le 26 et le 30 mars. Il est présent le 31, une anecdote montrant que le couple ne roulait pas sur l’or : Marc, doit en effet aller chercher des vêtements pour le défunt chez un cousin[43] dans le village…
Ils décèdent relativement jeunes (61 et 53 ans) et laissent un enfant (Henri) de 17 ans. Marc doit sans doute rejoindre la ligne Maginot très vite. Henri est donc placé comme commis agricole dans le village, chez Camille et Lucie REDOUTEY (les parents de Raymond REDOUTEY).
Il faut noter que notre lignée est très marquée par les décès prématurés : le père de Marc décède donc à 61 ans), mais son grand père paternel est mort à 50 ans, son arrière grand père à 58 ans, son arrière arrière grand père à 34 ans et son arrière arrière arrière grand -père à 55 ans. Sans parler de leurs épouses…
[1] à 85 km de chez lui
[1] Pertes du 51ème RMIC :
3000 hommes au 51° RMIC, à savoir 1000 hommes x 3 bataillons
- 330 morts le 14 juin (on admet que les décès se répartissent à 50/50 entre le 41° et le 51°) et les 660 à 1000 blessés probables (2 à 3 blessés pour 1 décès) – au total 33 à 45% de l’effectif hors de combat
= restent 1670 à 2000 soldats, répartis en 3 bataillons de 600 hommes environ.
La guerre
- une bonne partie du III/51°RMIC mis à mal sur le canal des Houillères les 17 juin.
- peut être 300 hommes du I/51°RMIC capturés le 20 juin près de Rehaincourt.
- les autres morts, blessés et égarés lors du repli du 15 au 22 juin (Avricourt, Charmes, Nompatelize, etc.)
On retrouve 300 hommes du I/51°RMIC à La Salle (à 13 km de St Dié) le 22 juin. Le reste du 51°RMIC (II/51°RMIC et III/51°RMIC) ne devait probablement pas rassembler plus de 600 à 800 hommes. Au total, 30 à 35% de l’effectif de départ. Mon grand-père était de ceux-là. [nota : quelques hommes du I/51°RMIC et le colonel DAGNAN rejoignent St Dié, où ils sont pris 2 jours plus tard, le 24 juin].
En 1940, Marc PILON fait partie de la 2ème compagnie d’engins (CE2), rattachée au 2ème bataillon du 51ème RMIC (II/51°RMIC). Si le Régiment compte 3 bataillons de 1000 hommes, la compagnie d’engins compte théoriquement 41 hommes, 2 mortiers de 81 mm[44], 2 canons de 25[45], pièces et munitions (150 par pièce) étant transportées dans 7 voiturettes hippomobiles.
Quand le 14 Juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte, à 400 kilomètres de là, en Lorraine, sur une ligne Saint-Avold-Sarralbe-Saint-Jean de Rohrbach, les combats se déclenchent, certainement les plus violents de la bataille de France.
Les Français, pour défendre ce secteur de la Ligne MAGINOT, disposent de quatre Régiments d'Infanterie de Forteresse, les 69e, 82e, 133e et 174e RIF. Ce dernier régiment constitue avec les 41ème et 51ème Régiments de Mitrailleurs d'Infanterie Coloniale le centre du dispositif du secteur fortifié de la Sarre, commandé par le Colonel DAGNAN.
Le 41ème RMIC, commandé par le Colonel TRISTANI, et le 51ème RMIC, commandé par le Lieutenant-colonel DE REVIERS DE MAUNY, comptent chacun de 3.000 hommes.
Le 14 juin, le 51ème RMIC occupe le sous-secteur de Sarralbe, de Schweix à Herbitzheim, sur un front de 12 kilomètres environ, s’appuyant sur le système d’inondations défensives des vallées de l’Albe et de la Sarre. Les fortifications du secteur sont particulièrement légères, s'appuyant sur des inondations (on parle de « ligne Maginot aquatique »).
Pour ce qui est du 2/51e RMIC, auquel appartient mon grand-père, il défend le Sud-Ouest de SARRALBE. Il est dirigé par le commandant BRUEL.
Du 3 au 7 juin 1940, il y a des escarmouches aux avant postes.
Le 13 juin, le colonel DAGNAN communique aux chefs de corps l’ordre d’évacuation pour le lendemain 21h. Cet ordre venu d’en haut est mal perçu. Ils n’auront pas le temps de l’exécuter…
Le 14 juin, le Général allemand VON WITZLEBEN Witzleben commandant la 1ère armée Allemande, déclenche l’opération Tiger. Il engage sur 25 km de front, de St Avold à Sarralbe, 9 divisions (dont 6 divisions d’infanterie en 1er échelon, c’est-à-dire près de 90.000 hommes), 259 batteries d’artillerie (environ 1000 canons), 25 escadrilles d’avions d’assaut (stukas) ou de bombardement (Heinkel). Une telle concentration de feux sur le front ouest ne sera égalée pendant les 2 conflits qu’à Verdun (1916), El Alamein et Monte Cassino.
L'attaque Allemande, précédée par une préparation d'artillerie d'une violence inouïe, commence à l'aube du 14. Les pionniers Allemands, masqués par des écrans de fumigènes coupent les réseaux de barbelés ou les font sauter. Les tirs d'artillerie s'allongent et les fantassins Allemands partent à l'assaut. Les Français se battent et tiennent leurs positions. Partout les Allemands sont stoppés et, à la mi-journée, le commandement Allemand avoue son échec. Durant l'après-midi l'effort est poursuivi avec acharnement et avec des moyens accrus. Les Stukas gênés par le brouillard, sur l'ouest du secteur, interviennent par vagues de 35 appareils, dès 7 heures sur le secteur d'HOLVING. Les HEINKEL 111 déversent des nappes de bombes sur les défenses Françaises, rasant du coup plusieurs villages.
Les combats sont acharnés. Seul l’ouvrage avancé du Knop tombe, dans le secteur du 51ème. Les contre-attaques permettent de maintenir partout le dispositif. Le 14 au soir, le groupement DAGNAN a remporté un remarquable succès défensif, au prix de pertes sévères (659 corps retrouvés) mais très inférieures à celles de l’ennemi (1200 à 1500 tués, 4000 blessés).
Mais, dans le cadre du repli du Groupe d’Armée 2, la mort dans l’âme, les régiments doivent abandonner leurs positions. Les unités décrochent dans la nuit, une à une en emmenant avec elles leurs blessés.
![]() Le 15 juin, le 51ème se replie et se positionne sur la ligne Sarre canal des Houillères. Le 1er bataillon (I/51°RMIC) a ordre d’aller tenir des bouchons sur la Moselle à Charmes. Les II et III/51°RMIC s’installent au nord du canal des Houillères. Marc y est sans nul doute.
Le 15 juin, le 51ème se replie et se positionne sur la ligne Sarre canal des Houillères. Le 1er bataillon (I/51°RMIC) a ordre d’aller tenir des bouchons sur la Moselle à Charmes. Les II et III/51°RMIC s’installent au nord du canal des Houillères. Marc y est sans nul doute.
Le 17 juin, les combats sont confus. Le III/51°RMIC est désagrégé et le II/51°RMIC, le régiment de Marc, se replie au sud du canal, à Avricourt. Le I/51°RMIC organise sa position à Charmes.
Le 18 juin, le II/51°RMIC entre Avricourt et Rechicourt. Il reçoit un ordre de repli.
Du 19 au 21 juin, le II et le III/51°RMIC se replient et freinent par coups d’arrêt successifs de courte durée (voir la carte page suivante).
Le 20 juin, le I/51°RMIC cède sous la poussée de l’ennemi. Il essaie de rallier la 70°DI mais le secteur est sillonné en tous sens par des colonnes allemandes. Il marche plein est et bouscule des allemands à Rehaincourt. Mais la plus grande partie du détachement se fait prendre par petits groupes.
Le 22 juin, 300 hommes du I/51°RMIC sont à La Salle (1 km au nord de La Bourgonce), 800 hommes du 41° à La Bourgonce. Il y a quelques escarmouches (dont une contre attaque vers Nompatelize), mais le cessez le feu est ordonné par le colonel DAGNAN. 500.000 soldats français sont encerclés entre Saint-Dié et Gérardmer lorsque l’armistice est signé. La France capitule.
Le gros du 51°RMIC se dirige vers St Dié. Après 150 ou 200 km parcourus plus ou moins à pieds en un semaine, mon grand père, Marc PILON (CE2 de du II/51°RMIC) est fait prisonnier à St Dié, dans les Vosges[46]. Ne reste alors qu’un tiers de l’effectif initial du régiment[47].
Captivité en Allemagne
Marc est selon toute probabilité, dirigé vers Strasbourg, qu’il rejoint sans doute en juillet[48], en partie à pieds (via le col de Saales et Sélestat).
De Strasbourg où il reste probablement 2 ou 3 semaines (caserne Stirn ?), il est envoyé en Allemagne via Kehl, pour rejoindre une gare (probablement Appenweier, à 15 km plus à l’Est). Direction les camps de prisonniers d’hommes de troupe (Stalag), à 50 hommes par wagon à bestiaux.
Marc passe a priori par Karlsruhe, Heilbronn, Nuremberg et Weiden. C’est dans l’une de ces 2 villes que lui est attribué son n° de matricule.
Il parcourt ainsi plus de 400 km vers l’Est et arrive le 23 juillet au Stalag XIII B[49] situé à Weiden in der Oberpfalz, à 80 km au nord-est de Nuremberg. Il y est inscrit sous le matricule 71108. S’ensuit a priori une désinfection, une tonte complète, le remplissage de documents administratifs et la confiscation de tous ses objets personnels…
Sa carte de capture[50] mentionne que le 15 décembre, il est encore dans le STALAG XIII B, affecté à l’Arbeitskommando 3112 (le stalag XIII B possédait 127 « Arbeitskommando », commandos de travail, dont 53 étaient des commandos de culture dans les villages). Il n’est pas blessé et se déclare en bonne santé.
Nous ne savons pas précisément où était ce kommando (il n’a pas été répertorié), mais le numéro 3112 suggère une localisation à l’est de Weiden, dans l’ouest de l’actuelle République tchèque, alors envahie par les allemands (ce que l’on a appelé les Sudètes). Si l’on en croit différents indices (notamment la localisation d’autre kommandos répertoriés avec un numéro proche de 3112), on se situe autour de Pöcken (actuellement Pěkovice[51], à 7 km au sud de Teplá et 100 km à l’Est de Weiden) ou de Tepl (aujourd’hui Teplá)[52]. Bref, assez loin au nord est du camp principal de Weiden
Nous ne savons pas combien de temps il reste affecté à ce kommando et ce Stalag. Il peut avoir changé de kommando à plusieurs reprises. Il est néanmoins très probable qu’il est redirigé assez vite bien plus loin à l’est, peut-être début 1941, peut-être un peu après. En effet, la plus grande partie de la guerre, il l’a passera dans une ferme en Prusse Orientale[53] (actuelle Pologne), « près de Varsovie ». Bref, 1000 km au nord-Est de ce kommando des Sudètes… Quand et comment cela s’est-il passé ? Nous ne le savons pas.
A ce stade, je n’ai pu précisément retrouver sa trace plus loin[54]. Mais on peut néanmoins cerner mieux les choses. Il existe alors 4 camps de prisonniers dans cette région du nord de la Pologne. On peut a priori exclure le STALAG 20A de Thorn, situé en Poméranie et non en Prusse Orientale, ainsi que le STALAG 20B de Mariemburg, où se trouvaient peu de français. Restent le STALAG 1A de Stablack, situé à 250 km de Varsovie et celui, plus proche de Hohenstein (le STALAG 1B). Je pencherais donc pour ce dernier, situé à environ 150 km au nord de Varsovie.
[1] Certains PG ont ainsi mis 10 jours pour rejoindre Strasbourg.
[1] Ce stalag comptera 10.000 prisonniers de guerre en 1944
[1] transmise au CICR, tamponnée au stalag le 22/01/1941
[1] kommando n° 2122
[1] kommando 3126 et suivants
[1] il ramènera de la Pologne le goût de faire des salades de lanières de choux tiédies au four
[1] il y a eu 1.845.000 soldats français capturés par l’armée allemande après la débâcle en juin 40, dont 250 000 parvinrent à s'échapper avant d'arriver en Allemagne. Reste environ 1.600.000 hommes. Or seulement 957 839 soldats sont recensés sur les 100 premières listes d’arrivées aux Stalags, établies entre le 12/08/1940 et le 15/06/1941. Nous n’avons par ailleurs que peu d’informations sur les transferts postérieurs vers d’autres camps, ce d’autant plus que les camps sont éloignés (comme le Stalag 1B)

![]()
![]()


|
|
Le Stalag 1B de Hohenstein (actuellement Olsztynek, en Pologne) est situé à l’extrême nord-est de l’empire allemand, à 80 km de l’enclave russe de Kaliningrad et à 250 km de la frontière biélorusse et lituanienne. Le Stalag compte 68.000 prisonniers au 1/08/1940, 22.000 au camp et 46.000 dans des commandos. 80% sont au départ des français, le reste étant composé de polonais (dans le camp depuis 1939, 16%) et de belges (4%). Viendront s’y ajouter des russes, qui connaîtront un sort terrible[55] et des italiens (10500 en septembre 1943).
[55] Ils sont 13000 en mai 1942 mais certaines sources indiquent 25.000 morts pendant l’hiver 41/42 (malnutrition, typhoïde). Le camp connaîtra malheureusement des massacres de masse (de plus de 20.000 russes et polonais).
Mais très vite, les prisonniers sont envoyés dans des kommandos (jusqu’à 17000 seront répertoriés). A partir de février 1941, 98% des prisonniers en kommandos sont des français. Le nombre de français en kommandos passe de 35.000 au 1er août 40 à 44.000 au 10 février 1941. Ensuite, les effectifs du camp central diminuent rapidement (ils passent de 22000 en 1940 à 7000 en février 1941, puis moins de 1000 jusqu’à la fin de la guerre). Il en est de même pour les effectifs en kommandos à partir de février 1941 : ils passent de 46000 en 1941 à 22000 en novembre 1944 (la quasi totalités sont des français).
Pour cette raison, on peut donc supposer, mais ce n’est qu’une pure conjecture, que Marc PILON est arrivé dans ce stalag début 41 (à partir de février, le nombre de PG en kommandos diminue et la demande est donc faible). De toutes façons, la Prusse Orientale voit se concentrer d’énormes moyens militaires au printemps 1941 (le 21/06/41, Hitler rompt le pacte germano soviétique et attaque l'URSS à partir de la Prusse orientale -opération Barbarossa-). Il est donc peu probable que les allemands aient mobilisé des moyens (et notamment des trains) pour y transférer des prisonniers français en mai ou juin 41.
Ce qui est certain, c’est que Marc PILON va rester, avec d’autres PG, dans une ferme de l’actuelle Pologne. Il ne semble effectivement pas qu’il ait connu différents kommandos (il aurait alors parlé de fermes et aurait sans doute émis quelques comparaisons). Cette ferme se situe selon toute vraisemblance au sud de la Prusse orientale, dans une région appelée Mazurie (en polonais : Mazury ; en allemand : Masuren), dans l’actuelle région administrative polonaise (voïvodie) de Varmie-Mazurie.
Les kommandos sont disséminés dans une région assez vaste, qui commence à 150 km au nord de Varsovie (Nidzica), qui s’étend sur 100 km plus au nord et sur 200 km d’est en ouest (de Morag à Elk).
C’est une région de lacs (3000) et de forêts. Région de transition entre la culture germanique et la culture slave[56], la population a fait le choix en 1920 du maintien dans la Prusse et donc dans l’Allemagne[57]. La langue officielle est d’ailleurs l'allemand depuis 1834, même si, dans le sud de la Prusse orientale, on parle aussi, et probablement tout autant, le mazurien, un dialecte polonais. Le climat y est plus froid[58] que dans la plupart des parties de la Pologne et la zone est enneigée pendant l'hiver.
[56] Les Mazuriens s'appellent entre-eux des « Prussiens polonais » ou « Staroprusaki » (Vieux prussiens). Ils ont montré un soutien considérable pour l'insurrection de la Pologne en 1831, et maintenu de nombreux contacts avec la Russie et les zones tenues par la Pologne au-delà de la frontière de la Prusse, les zones étant reliées par une culture et une langue commune. Il y a une politique de germanisation en Mazurie avec des tentatives de propager la langue allemande et d'éradiquer, autant que possible, la langue polonaise.
[57] Dans un plébiscite la Mazurie vote à 99,32% pour rester avec la Prusse orientale
[8] des hivers froids (-3 à -6°C en moyenne en janvier, mois le + froid) et des étés chauds de juin à août (21°C en juillet).
[59] Certains prisonniers étaient plus ou moins gardés, ou on leur confisquait leurs chaussures le soir
Les conditions de captivité de Marc sont rudes. Quelques camarades dans une cabane en bois. Je comprends mieux cette anecdote que Marc PILON racontait, l’utilisation du même pot la nuit pour faire ses besoins et le jour pour faire la cuisine : dehors il fait froid (ou la porte est fermée…[59]) et les conditions de confort sont sommaires.
La nourriture est une préoccupation importante. Il essaie bien de prendre quelques lapins ou lièvres au collet… A son retour, il semble cependant qu’il n’ait pas beaucoup maigri, et il restera toujours friand d’un plat de choux en lanières, passés rapidement au four avec des lardons et arrosés de vinaigre (en outre, il ferait de temps en temps, après guerre, du chou farci, sa spécialité).
Commence une période très longue, sans informations, sans fin. Un premier été, où il faut se dépêcher de réaliser les travaux agricoles, puis l’hiver, long. Sans doute des travaux de bûcheronnage et l’entretien des animaux (il s’occupe notamment des chevaux). Les mois passent.
Sans famille pour lui envoyer des colis (ses parents sont décédés et son frère a 17 ans en 1940), isolé, il se voit attribuer (peut-être à sa demande) une « marraine de guerre ». Mme VENDERCAMER[60], installée à Paris (mais plus tard à Toulon), va beaucoup s’occuper de lui. Elle lui envoie des colis et il lui en sera toujours reconnaissant[61] . Ce sera en fait son seul lien avec la France pendant presque 5 ans.
Nous n’avons pas de correspondances de cette époque, mais, au vu de ce qu’écrivaient bon nombre d’autres prisonniers de guerre, il est certain que dans ces échangent contingentés[62] (et d’autant plus rares que l’on est éloigné du camp central) on parle beaucoup de colis. Des remerciements, des demandes particulières (nourriture, pièces de vêtement, etc.) et quelques nouvelles. Pas de localisation ou d’échanges sensibles, la censure veillant.
Quel est son moral ? Un 2ème été puis un nouvel hiver. Sans fin. Les rapports du CICR (Comité International de la Croix Rouge) concernant le Stalag 1B nous indiquent que le travail agricole est souvent long et pénible. Surtout, ils décrivent de grosses difficultés d’habillement (pantalons en loques, etc.). Seulement 1/3 des prisonniers sont dotés de chaussures en 1943, les autres ayant des sabots. Les colis semblent arriver de façon très irrégulière dans les détachements de travail (souvent éloignés).
Encore un été, et un long hiver. Les mois et les années s’enchaînent, sans changement, sans perspective. Encore un été. Toujours les mêmes problèmes de vêtements et de correspondances : il n’y a qu’un seul camion pour livrer les colis ds les kommandos, sur un territoire grand comme la Suisse...
Globalement, l’état sanitaire des prisonniers du stalag se dégrade en 1944.
A l’automne, les choses s’accélèrent brutalement. En effet, les russes lancent une vaste offensive à l’Est, au moment où les anglo-américains débarquent en Normandie[63]. Entre le 22 juin et le 19 août 1944, ils avancent de 600 km vers l’ouest, sur un front de 1000 km. Ils sont arrêtés à la frontière est de la Prusse Orientale, au contact des kommandos de travail les plus à l’est du Stalag 1B (Goldap, Treuburg/Olecko, Lyck/Elk). Il est évident que les prisonniers de guerre français, même éventuellement à plus de 50 km du front, savent que les russes avancent. Les civils en parlent avec crainte et certains prisonniers sont mobilisés dès l’été pour des travaux de terrassement défensifs (fossés anti-char, blockhaus).
Entre le 16 et le 27 octobre, les russes pénètrent de 30 à 60 km en Prusse Orientale mais subissent de fortes pertes et doivent reculer. La menace d’une invasion pèse sans doute fortement sur les populations mais aussi sur les prisonniers de guerre, les russes ayant commis des atrocités là où ils ont pénétré.
Les prisonniers de guerre sont affectés au creusement de nombreuses tranchées antichar, parfois très près du front. Les conditions sont alors précaires. Outre le risque lié aux hostilités et les conditions de travail[64], les prisonniers français se retrouvent sous le commandement des membres du parti nazi (NSDAP) et non de la Wehrmacht (gardiens du Stalag). Ils n’ont souvent pas d’éléments distinctifs sur leurs vêtements (pas de sigle Kgf –Kriegsgefangener- ou de triangle rouge) : en cas de prise par les russes, ils peuvent être assimilés à des soldats des arrières. Les prisonniers craignent d’être abandonnés par les allemands en cas d’offensive russe et d’être passés immédiatement par les armes s’ils sont pris…
[60] je n’ai pu retrouver sa trace : la famille VANDERCAMER vient de la région de Tourcoing. L’orthographe est probablement bien celle-ci : il existe des VAN DER KAMER et VANDERKAMER en Belgique et aux Pays Bas (origine), mais aucun ne naît en France entre 1892 et 1990.
[61] elle reste proche après guerre jusque dans les années 70 (la fille de Marc lui rendra visite en août 1970 au cours de son voyage de noce)
[62] le prisonnier peut écrire une lettre et 2 cartes postales par mois au maximum
[63] opération Bagration
[64] les prisonniers sont affectés aux tranchées pour quelques semaines, mais y restent jusqu’à 3 mois. Ils en ressortent amaigris et souvent malades
Pour ceux qui ne sont pas affectés aux tranchées, il est certain que les craintes montent progressivement (les civils sont très inquiets). Il y a de gros problèmes de distribution de colis. Les lettres deviennent exceptionnelles… Ils sont de plus en plus coupés du monde.
La situation est certainement de jour en jour plus incertaine. Est-ce à ce moment que Marc envisage sérieusement de s’évader, de « se sauver » ? Il s’en ouvre dans un (ou plusieurs) courrier(s) à Mme VENDERCAMER, forcément à mots couverts, les courriers étant systématiquement relus par une censure allemande très attentive. Quoiqu’il en soit, ils se comprennent et elle lui fait passer dans un colis une petite boussole d’environ 8 mm de diamètre[65] dans une coque de noix. Cela nous indique qu’il sait à peu près où il se trouve mais qu’il n’a pas de moyen autre que le jugé pour savoir où aller. Pas de carte, pas de réseau ferré. Il fallait sans doute un grand courage pour imaginer rentrer chez soi par ses propres moyens et traverser le territoire allemand sur près de 1500 km.
A quel moment a-t-il reçu cette boussole ? Si c’est avant 1945, il est certain qu’il ne l’a pas utilisé (il en aurait parlé et serait rentré avant le 8 mai 45). Mais si c’est début 1945, il est possible qu’il l’ait utilisé. En effet, à partir du 13 janvier 45, l'offensive soviétique aboutît à l'évacuation massive de la Prusse-Orientale, entraînant les prisonniers de guerre des kommandos éclatés dans la masse des réfugiés civils et de la Wehrmacht se repliant vers l'ouest.
Le 20 janvier 1945, les prisonniers du Stalag1B quittent le camp central, déserté par les soldats allemands (à ce moment là, le front se trouve au sud, à 15 kilomètres du camp). Ils se déplacent au moins pour partie un peu plus au nord à Marienburg (Stalag XXB). Mais les hommes du camp principal et des kommandos sont rapidement livrés à eux-mêmes.
Prisonniers de guerre, civils, paysans (femmes, enfants, vieillards), soldats de la Wehrmacht en pleine débandade, tous fuient devant les russes[66], par un froid polaire et sous des feux croisés des allemands en déroute et des russes. Ceux-ci se montrent du reste très brutaux et commettent de nombreuses exactions (vol systématique, viols, exécutions sommaires).
Certains PG ne peuvent plus s’enfuir vers l’ouest et se retrouvent derrière les lignes russes et donc en territoire dorénavant soviétique (certains pourront rentrer en France via l’Ukraine –Odessa-, la Mer Noire et la Méditerranée –Marseille-). Mais la grande masse des PG, dont probablement Marc PILON, se dirige néanmoins vers l’ouest[67]. Ils marchent dans un pays en ruines pendant plusieurs semaines, pour certains pendant plus de 3 mois.
Fin avril 45, la plus grande partie des prisonniers est arrivée dans la Wehrkreis II (Stettin est située à 460 km à l’ouest d’Olsztynek) et marche vers l'Ouest dans la direction du Wehrkreis X (Hambourg, situé à 860 km d’Olsztynek). Ils ont fait parfois fait tout ce chemin à pieds, dans le dénuement le plus complet…
[65] Cette boussole existe toujours. Elle est propriété de sa femme, Jeanne PILON (Jésonville)
[66] L'exode de la Prusse-Orientale est l’un des plus importants de l'histoire humaine. Ce sont surtout des femmes, des vieillards et des enfants qui furent jetés sur les routes. La population de la province qui était de 2 400 000 en 1944, ne se retrouve qu'à 193 000 en mai 1945, après un hiver particulièrement rude.
[67] Après guerre, il n’a jamais évoqué la Russie ; l’Ukraine ou d’Odessa
En mai, des centres de rassemblement se sont formés à l'intérieur de l'Allemagne non loin des frontières hollandaise, belge et française (tels ceux de WESEL, KEVALAER, REES, HAMMINKEIN, BOCHOLT). Les évacuations vers la France par trains ou camions se poursuivent à une cadence telle qu'aucun Français ne demeure pratiquement plus de quatre jours dans ces centres.
Rapatrié le 8 mai 1945 (c’est étonnamment la date de la capitulation de l’Allemagne), Marc PILON arrive à Nancy le 20 mai 1945, où il passe une visite médicale[68] rapide, qui nous apprend qu’il pèse 60 kg (4 de moins qu’avant la guerre) et se porte assez bien, hormis quelques caries. Il est démobilisé par le centre démobilisateur d’Epinal le 21 mai 1945[69].
[68] sur sa fiche médicale, c’est le stalag XIIIB qui est mentionné, mais il est très peu probable qu’il s’agisse du bon Stalag. S'il avait été tout à l'est des Sudètes, il n'aurait pas parlé de Varsovie (situé à 500 km) mais de Prague (160 km) ou de Cracovie (150 km). En outre, il n'aurait pas parlé de Prusse Orientale
[69] Il passe par Nancy le 20/08, où une fiche médicale est remplie
Après guerre
De 1945 à 1949, Marc vit à Jésonville, dans la maison familiale (il semble que son jeune frère Henri, qui a alors un peu plus de 20 ans, reste chez ses employeurs).
photo de mariage - 1949
Marc se marie le 4 juin 1949 avec Jeanne LOSSEROY, fille d’agriculteurs modestes de Jésonville (elle a 22 ans, lui 38).
Trois enfants naissent successivement : Claude en 1950, Eliane en 1951 et Gérard en 1956.
Marc travaille comme maçon (il construit alors des maisons traditionnelles en pierre, une maison représentant 1 an de travail), d’abord à Bonvillet, chez COLNET, puis à Darney, chez MENOTTI. Il y va avec une mobylette Motobécane bleue…
Marc, Jeanne, Eliane, Claude et Gérard en 1964
[1] contre leur maison, près de chez SCHAD et chez Tan’Clémence (abandonné dans les années 70)
[1] il met aussi une ceinture de flanelle pour protéger ses reins
[1] il est ouvrier chez FOURNIER à Harol
Marc modifie profondément la maison avec l’aide de collègues de chez MENOTTI : suppression de la grange, déplacement de la porte d’entrée, création d’un escalier et de 2 chambres à l’étage à la place des greniers, installation d’un évier dans la cuisine et suppression de la « pierre d’eau », etc.
Comme tout le monde, ils élèvent quelques poules, des lapins et font beaucoup de jardin (ils en ont jusqu’à 3[70]).
La famille ne roule pas sur l’or. Marc met encore parfois des « chaussettes russes » dans ses bottes (il s’agit d’une pièce de tissu enroulée autour du pied… Vestige du temps passé en Pologne ?).[71]
Signe que le passé n’est pas oublié, Mme VANDERCAMER envoie chaque année un colis aux enfants, colis qui est très apprécié.
En 1957, leur fils Claude (il a 7 ans) part vivre dans la ferme de sa grand-mère, Eugénie LOSSEROY (« Ninie »), où, après le travail[72] il s’occupe de la ferme avec 3 oncles célibataires, Roger, Henri (« Riquet ») et Marcel.
Marc, plutôt « taiseux », essaie toujours d’améliorer l’ordinaire : Marc chasse et va aux champignons. Il va aussi, de nuit, attraper de nombreuses grenouilles dans un sac. Il aime aussi écouter la radio, notamment l’émission de « la mère Tabouis » (comme il l’appelle) qui passe à 19h[73].
[70] contre leur maison, près de chez SCHAD et chez Tan’Clémence (abandonné dans les années 70)
[71] il met aussi une ceinture de flanelle pour protéger ses reins
[72] il est ouvrier chez FOURNIER à Harol
En 1969, malade, Marc bénéficie d’une mise en retraite anticipée. Il a 58 ans
En 1970, Eliane se marie avec Alain Grandclerc, mon père.
A partir du début des années 70, Marc se consacre alors presque à temps plein à la cueillette des champignons (il connaît tous les « coins » à champignons autour de Jésonville, jusqu’à Hennezel… et il les tient secrets) et à divers bricolages.
Il va également à la chasse (à l’époque, il y avait peu de gros gibier : il chasse essentiellement le lièvre, la bécasse –le soir, seul, à l’affût- ou le pigeon –ce qui n’empêche pas qu’il doive parfois ramener dans son frigo un corbeau, faute de pigeons…-).Il
Il Il Il aime aussi beaucoup ses vergers. Il taille, greffe (y compris dans les haies), aime les arbres fruitiers, sa vigne et ses jardins. Très habile de ses mains, Marc réalise encore à l’occasion des travaux de maçonnerie, mais il fait aussi de la vannerie[74] (il entretient 2 ou 3 pieds de saule au chemin du bois), travaille le cuir, le bois (il a beaucoup d’outils).
Il aime toujours écouter la radio, souvent tôt le matin, en buvant son café dans un verre, sans le faire bouillir (« café bouillu café foutu »). Il aime la politique (il est socialiste convaincu).
Petit, taiseux, je le revois se rouler lentement une cigarette, à la main ou avec une rouleuse (il fume du « petit gris » avec des feuilles JOB).
Arnaud GRANDCLERC – janvier 2015
La maison reste néanmoins joyeuse, autour de grands repas familiaux avec moult récits de chasse (Jeanne est une excellente cuisinière, pleine de générosité –elle utilise 2 cuisines-).
vers 1980
La santé de Marc se dégrade courant 1984 : il doit dès lors être dialysé régulièrement. Cela dure quelques mois : il décède des suites de problèmes rénaux à l’hôpital de Vittel le lendemain de Noël 1984, à 73 ans. Il laisse une épouse, 3 enfants et 2 petits enfants (il en naîtra 5 autres ultérieurement.
Ecrit par Arnaud GRANDCLERC – janvier 2015
[1] il est né le 4 mais déclaré en mairie le lendemain
[2] une naissance en 1518 à St Malo. Les 1ères naissances à St Méloir sont notées en 1548
[3]mariage au Rouilly (aujourd’hui Rahart) en 1570, naissances nombreuses à Azé dès1570, à Mazangé dès 1580. Quelques naissances sporadiques (St Ouen en 1610, Danzé en 1620, Ambloy en 1645, Champigny en Beauce en1650, Thoré la Rochette en1650)
[4] 111 naissances dans le Loir et Cher entre 1891 et 1915. 1 Pilon sur 6 est né dans ce département à cette époque. 2ème département : la Sarthe. Les Vosges viennent en 8ème position avec 22 naissances sur la période. On notera que le nom de famille PILON n’est ni rare ni en régression : 689 naissances entre 1891 et 1915, 877 entre 1916 et 1940, 1314 entre 1941 et 1965, 1213 entre 1965 et 1990.
[5]Au-delà de St Méloir (35), de Mazangé (41), de Paris (75) et de Metz (57), on note d’autres naissances, à Cancale (35) en 1548, à Chemault (45) en 1559, à Achères (78) en 1565, et au Rouilly (41) en 1570
[6]Aucune des créations d'André Pilon n'a été conservée, de sorte que l'on ne peut apprécier son style. Certaines commandes révèlent toutefois sa prédilection pour les statues en bois peint et pour la terre cuite, ce qui laisse supposer qu'il se rattachait au monde des formes médiévales
[7]Le 6 août 1567, le gouverneur de Vieilleville autorise quatre Juifs (Isaac, Mardochée, Michel et Gerson) à résider définitivement à Metz sous certaines conditions : ils entendront chaque mois un sermon dans une église, le taux maximum de prêt est de 21 % et il leur faudra payer une redevance annuelle au profit des pauvres de la ville. Ils ont également interdiction d'habiter sur les rues principales et les places de la ville. Malgré l'opposition des notables locaux, de 4 ménages on passe à 9 en 1594. Nos ancêtres étaient-ils de ceux là ? Ce qui est certain, c’est que la communauté s’agrandit : elle compte 25 ménages en 1625 (soit 120 personne). En 1637, la communauté se monte à 373 personnes. Elle est confinée dans le ghetto aux hautes maisons et aux ruelles étroites.
[8] Le nom ne semble pas juif, mais avant le décret de 1808, les Juifs de France portaient souvent déjà des noms "de famille" (qui étaient, à l'origine, des surnoms) transmissibles de père en fils. En dehors des descendants des anciennes castes sacerdotales, qui se transmettaient le nom de Cahen ou de Lévy, ces noms rappelaient souvent le lieu d'origine de la lignée. C'est ainsi qu'à Metz, la plupart des gens portaient un nom "de famille" héréditaire. En 1637, ces noms évoquent une provenance d’Allemagne (Hanau, Trèves, Francfort, etc.).
[9] Anne Josues (1590), Daniel Josues (1592), Jeremie Josues (1595), Samuel Josues (1598), Esther Josues (1602), David (1603), Rachel (1605), Israle Josues (1606) et Michael Josues (1607)
[10] Le fils de Josues, Daniel Josues aura un enfant né en 1622 à Metz mais qui décède Houwerzijl (Pays Bas). Toute cette branche semble avoir prospérée dans ce pays.
[11] Le prénom notamment
[12]il est douteux que le Prévôt du Chapitre d’Epinal ait épousé une femme de confession juive. Voir la note précédente
[13] leur fille Barbe naît à Corcieux vers 1646 et décède à Orbey (Haut Rhin) en 1689
[14] il est laboureur
[15] les petits enfants se marieront à Gigney
[16] de mon fils Nicolas GRANDCLERC à son aïeul Nicolas PILON
[17] c’est-à-dire l’année où Louis XV impose son beau père, Stanislas Leszczyński,, comme Duc de Lorraine, le dernier Duc, François III se voyant proposer en échange le royaume de Toscane (ce qu’il accepte malheureusement)
[18] les 2 premiers se marient aux Ableuvenettes et à Charmois l’Orgueilleux, où ils feront souche. 2 autres enfants suivent après François mais nous ne savons pas s’ils auront une descendance (la lignée de Ville sur Illon s’éteint par la suite)
[19] Ses parents et grands parents, dont on ne sait où ils sont nés, sont tous décédés à Jésonville. Ils sont présents à Jésonville depuis au moins 1695 (avec les Remy, Henri, Noël, Poirot, Ferry, les Busiot composent le petit noyau d’habitants du village post Guerre de Cent Ans
[20] Gisonville en 1290, Gesonville et Jezonville en 1297, Jesonville en 1591, Gezonville en 1724, etc., de Gisonis villa
[21] à comparer aux 233 habitants que comptera le village en 1793 (la population est multipliée par 10 en 67 ans) et aux 449 habitants de 1841
[22] Se prononce sans doute « Matè » (MATHEY)
[23] peut-être la même personne que « Jean Nicolas »
[24]Le grand-père, François PILON, décède peu après (1790)
[25] même si le prénom est très populaire au 19ème siècle, on observe que très curieusement beaucoup de PILON seront prénommés Joseph, ou Joséphine (associés à d’autres prénoms) à partir de la Révolution
[26]30 minutes, mort né, 16 jours…
[27] 449 habitants à Jésonville en 1847, soit près de 80 de plus qu’en 1830. La population redécroit rapidement (385 en 1867)
[28] autorisation donnée par le Préfet. Il semble que Jean-Baptiste habite alors à Darney (s’agit-il d’un homonyme ?)
[29] prénom déclaré à l’Etat Civil, construit sur Stanislas, peut-être en référence à Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV, qui sera Duc de Lorraine entre 1737 et 1766
[30] il faut y ajouter le fait que d’autres branches connaissent le même sort. Par exemple, sur les 4 enfants de Joseph dit Emile PILON, 3 décèdent en très bas âge…
[31] les 3 ont parmi leur prénom celui de Joseph
[32] conseiller municipal entre 1900 et 1911. Chasseur
[33] où sera installée la cabine téléphonique du village en 1925
[34] recensement de 1906
[35] maison Gilbert DURANT. Source D. Audinot
[36] maison Dominique CANAUD, rue du Vial
[37] je crois me souvenir que c’est ce que m’a dit mon grand-père
[38] on notera qu’aucun enfant ne naît pendant la guerre
[39] Stanis PILON meurt en 1892 et Jean-Baptiste JEANROY en 1908
[40] on ne sait quand est décédée Eugénie THYRIET, l’épouse de Jean-Baptiste JEANROY
[41] le14 février 1914, elle fait une demande de soutien de famille à la commune, en faveur de son fils Marie Adrien qui doit être incorporé en octobre 1914. Le Conseil Municipal, vu sa « situation peu aisée » donne un avis favorable à la demande.
[42] pas retrouvé pour l’instant. Il pourrait s’agir d’une entreprise dont le nom commence par PETIT (PETITCOLIN, PETITCUNIN, PETITDEMENGE, PETITDEMANGE, PETITJEAN, PETITCOLAS, PETITDIDIER, PETITNICOLAS ?), voire PETELOT
[43] Pierre SCHAD, marié à Margueritte PILON, qui tiennent un café (près du jardin de Marc)
[44]Calibre: 81 mm. Masse: 54 kg. Cadence de tir: 20 c/min. Portée: 1 200 m. Conçu et fabriqué par les Établissements Brandt, c'est une arme simple et efficace. Il est chargé par la bouche, la munition étant mise à feu en tombant sur un percuteur fixe. Il nécessite une équipe de 3 hommes. Il est démontable en 3 fardeaux et muni d'un bipied.
[45]canon antichar Français de 25 mm Hotchkiss modèle 1934. Calibre : 25 mm. Vitesse initiale : 920 m/s. Vitesse de tir : 15 à 20 coups/minute. Longueur : 3,71 m. Longueur du canon : 1800 mm. Poids : 496 kg
[46] à 85 km de chez lui
[47] Pertes du 51ème RMIC :
3000 hommes au 51° RMIC, à savoir 1000 hommes x 3 bataillons
- 330 morts le 14 juin (on admet que les décès se répartissent à 50/50 entre le 41° et le 51°) et les 660 à 1000 blessés probables (2 à 3 blessés pour 1 décès) – au total 33 à 45% de l’effectif hors de combat
= restent 1670 à 2000 soldats, répartis en 3 bataillons de 600 hommes environ.
- une bonne partie du III/51°RMIC mis à mal sur le canal des Houillères les 17 juin.
- peut être 300 hommes du I/51°RMIC capturés le 20 juin près de Rehaincourt.
- les autres morts, blessés et égarés lors du repli du 15 au 22 juin (Avricourt, Charmes, Nompatelize, etc.)
On retrouve 300 hommes du I/51°RMIC à La Salle (à 13 km de St Dié) le 22 juin. Le reste du 51°RMIC (II/51°RMIC et III/51°RMIC) ne devait probablement pas rassembler plus de 600 à 800 hommes. Au total, 30 à 35% de l’effectif de départ. Mon grand-père était de ceux-là. [nota : quelques hommes du I/51°RMIC et le colonel DAGNAN rejoignent St Dié, où ils sont pris 2 jours plus tard, le 24 juin].
[48] Certains PG ont ainsi mis 10 jours pour rejoindre Strasbourg.
[49] Ce stalag comptera 10.000 prisonniers de guerre en 1944
[50] transmise au CICR, tamponnée au stalag le 22/01/1941
[51] kommando n° 2122
[52] kommando 3126 et suivants
[53] il ramènera de la Pologne le goût de faire des salades de lanières de choux tiédies au four
[54] il y a eu 1.845.000 soldats français capturés par l’armée allemande après la débâcle en juin 40, dont 250 000 parvinrent à s'échapper avant d'arriver en Allemagne. Reste environ 1.600.000 hommes. Or seulement 957 839 soldats sont recensés sur les 100 premières listes d’arrivées aux Stalags, établies entre le 12/08/1940 et le 15/06/1941. Nous n’avons par ailleurs que peu d’informations sur les transferts postérieurs vers d’autres camps, ce d’autant plus que les camps sont éloignés (comme le Stalag 1B)
[55] Ils sont 13000 en mai 1942 mais certaines sources indiquent 25.000 morts pendant l’hiver 41/42 (malnutrition, typhoïde). Le camp connaîtra malheureusement des massacres de masse (de plus de 20.000 russes et polonais).
[56] Les Mazuriens s'appellent entre-eux des « Prussiens polonais » ou « Staroprusaki » (Vieux prussiens). Ils ont montré un soutien considérable pour l'insurrection de la Pologne en 1831, et maintenu de nombreux contacts avec la Russie et les zones tenues par la Pologne au-delà de la frontière de la Prusse, les zones étant reliées par une culture et une langue commune. Il y a une politique de germanisation en Mazurie avec des tentatives de propager la langue allemande et d'éradiquer, autant que possible, la langue polonaise.
[57] Dans un plébiscite la Mazurie vote à 99,32% pour rester avec la Prusse orientale
[58] des hivers froids (-3 à -6°C en moyenne en janvier, mois le + froid) et des étés chauds de juin à août (21°C en juillet).
[59] Certains prisonniers étaient plus ou moins gardés, ou on leur confisquait leurs chaussures le soir
[60] je n’ai pu retrouver sa trace : la famille VANDERCAMER vient de la région de Tourcoing. L’orthographe est probablement bien celle-ci : il existe des VAN DER KAMER et VANDERKAMER en Belgique et aux Pays Bas (origine), mais aucun ne naît en France entre 1892 et 1990.
[61] elle reste proche après guerre jusque dans les années 70 (la fille de Marc lui rendra visite en août 1970 au cours de son voyage de noce)
[62] le prisonnier peut écrire une lettre et 2 cartes postales par mois au maximum
[63] opération Bagration
[64] les prisonniers sont affectés aux tranchées pour quelques semaines, mais y restent jusqu’à 3 mois. Ils en ressortent amaigris et souvent malades
[65] Cette boussole existe toujours. Elle est propriété de sa femme, Jeanne PILON (Jésonville)
[66] L'exode de la Prusse-Orientale est l’un des plus importants de l'histoire humaine. Ce sont surtout des femmes, des vieillards et des enfants qui furent jetés sur les routes. La population de la province qui était de 2 400 000 en 1944, ne se retrouve qu'à 193 000 en mai 1945, après un hiver particulièrement rude.
[67] Après guerre, il n’a jamais évoqué la Russie ; l’Ukraine ou d’Odessa
[68] sur sa fiche médicale, c’est le stalag XIIIB qui est mentionné, mais il est très peu probable qu’il s’agisse du bon Stalag. S'il avait été tout à l'est des Sudètes, il n'aurait pas parlé de Varsovie (situé à 500 km) mais de Prague (160 km) ou de Cracovie (150 km). En outre, il n'aurait pas parlé de Prusse Orientale
[69] Il passe par Nancy le 20/08, où une fiche médicale est remplie
[70] contre leur maison, près de chez SCHAD et chez Tan’Clémence (abandonné dans les années 70)
[71] il met aussi une ceinture de flanelle pour protéger ses reins
[72] il est ouvrier chez FOURNIER à Harol
[73] Geneviève Tabouis se fait connaître de la France entière sur Radio Luxembourg de 1949 à 1981 par ses chroniques politiques, avec notamment les Dernières nouvelles de demain qu'elle entame invariablement par sa célèbre phrase fétiche « Attendez-vous à savoir »
[74] où l’a-t-il appris ?