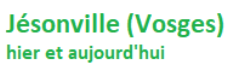Origine des forêts communales
- Détails
- Catégorie : Forëts
- Publié le mercredi 10 janvier 2024 16:09
- Écrit par Daniel AUDINOT
- Affichages : 43
- Publié le jeudi 17 février 2022 11:02
- Écrit par Daniel AUDINOT
- Affichages : 42
Origine des forêts communales
La forêt communale a plusieurs origines la première selon Claude GUYOT est le système d’exploitation pratiquée dans le mance dés l’époque Franque. Le paysan avait le droit d’utiliser la forêt de son maître : la tenue qui lui était concédée, sous forme de terre de terrain à essarter, était insuffisante pour faire vivre sa famille et payer les redevances ; un complément indispensable devait être trouvé dans la forêt qui restait incluse dans la réserve du propriétaire : chauffage, bois d’œuvre pour construire ou réparer sa maison, fabriquer outils et charrois ; pâturage pour le bétail. Chaque tenancier d’un même mance se voyait reconnaître les mêmes droits. Sur un même ban, plusieurs communautés de tenanciers ont pu se constituer ce qui exigea une réglementation pour une utilisation collective entre les villages (ban d’Uxegney par exemple).
Une autre origine des forêts communales, ce sont les concessions ducales et seigneuriales, faites à titre d’ascensement dans la Montagne et dans la Vôge. Le censitaire recevait une portion de forêt à défricher, « un retrait de bois », pour établir sa grange et faire un peu de terre labourable ou des prairies de fauche et le droit d’user de la forêt en commun avec les autres censitaires. Les ascensements permirent aux ducs de Lorraine d’augmenter le domaine forestier, aux dépens des abbayes et des chapitres de Lorraine dont il s’était fait les protecteurs ; de ces ascensements ducaux et seigneuriaux naquirent en 1793 des forêts communales, alors que les forêts ecclésiastiques furent rattachées au Domaine de l’État à la Révolution.
Quelque soit l’origine de la forêt communale, jusqu’à la Révolution, les habitants des communautés n’eurent que des droits d’usage et non une propriété. Les usages forestiers sont nombreux et presque gratuits ; ils peuvent s’exercer en toute liberté pour les menus produits avec autorisation pour le bois de qualité.
Ainsi après la Révolution les communes possédant un droit d’usage sur les ascensements ducaux ou seigneuriaux devinrent propriétaires de la forêt correspondant à ces ascensements. Les cantonnements des droits d’usage sous Napoléon III, autour des années 1860 permirent à de nombreuses communes soit d’agrandir leur forêt communale (ex Lerrain, Dombasle devant Darney) ou de leur en constituer une (Ex Jésonville).
Précisons ce droit d’usage : nb
L’usage au bois : Les habitants ont droit au bois de feu (affouage). À cet effet des coupes spéciales, dit affouagères sont affectées. Souvent on n’indique pas la manière dont l’affouage est attribué, mais seulement les essences à utiliser, les essences inférieures dont on usera « en bon père de famille ; le mort – bois ne sera utilisé qu’après épuisement du bois mort.
« Bois mort, et bois sec, debout ou gisant ; peut-être pris par l’usager partout où ils se trouvent. « Le mort – bois comprend, les aulnes, genêts, épines et autres bois ne portant pas de fruits autrement dit les blanc-bois. Quant aux bois de charpente et de construction, il doit être délivré par l’agent forestier, le gruyer, qui le marquera et l’assignera.
L’afforestage permet enfin de se procurer le matériau nécessaire à la fabrication d’outillage agricole et des charrois. Certains usages très spéciaux pourront être accordés, par exemple le droit de faire de l’écorce, de cueillir des produits comestibles sauf pour les glands et les faînes. Le droit de chasse n’est jamais accordé et le braconnage est sévèrement réprimé. Le droit au pâturage est permis aux communautés qui ne possèdent que quelques prés. Mais ce droit est réglementé pour défendre la forêt de la dent du bétail. Comme sur les terres après la moisson ou dans les prés après la fenaison, la vaine pâture peut être pratiquée en tout temps après la coupe du bois et en dehors de la glandée. S’il n’y a ni chêne, ni hêtre, le parcours est libre et sans limite. Le troupeau est collectif. Quelques restrictions protègent les jeunes plants : « le bois – taillis est en défens jusqu’à ce que le rejet soit de cinq feuilles ». La durée de l’interdit peut aller de trois à neuf ans mais jamais plus du quart de la forêt ne peut être mis en défens.
La grasse pâture permet de lâcher les porcs dans la forêt, de faire consommer les glands et les faines à l’époque de leur dissémination. Le gaulage est toléré mais il est interdit de ramasser ces fruits pour nourrir le bétail à la ferme ou pour les vendre. Ce droit de glandée ou panage qui n’est pas gratuit est strictement réglementé dans le temps. Deux glandées successives ou non « depuis la Fête de Notre Dame de septembre jusqu’au jour de Saint André, et le recours depuis la Saint André jusqu’à la Saint Georges »
Extrait de : Forêts communales et communautés rurales dans le département des Vosges par Geneviève DIETRICH. Revue Géographique de l’este, année 1976 volumes 16 numéro. Page 41 à 61
Extrait de Note du préfet des Vosges à l’Empereur Napoléon III sur le cantonnement des usagers dans les forêts domaniales des Vosges le 6 juillet 1856 p192
Droits d’usage en bois. Origine et nature de la concession.
« Un grand nombre de forêts domaniales sont grevées de droits d’usage au profit des habitants des communes qui les avoisinent.« Ces droits ont une origine ancienne. Ils ont été concédés par les anciens souverains, par les seigneurs ou par les abbés, prieurs des couvents les plus riches des États ou provinces qui composent maintenant l’Empire français.
«La concession consiste généralement en droits de pâturage, de glandée et de panage et en droits d’usage en bois. Nous ne nous occuperons que de ces derniers, en vertu desquels les usagers peuvent réclamer au propriétaire de la forêt une quantité déterminée ou indéterminée de bois de chauffage, et en outre quelques fois tous les bois nécessaires à la construction des maisons, à l’établissement des fontaines et aux besoins des populations agricoles.
«Cette concession a eu pour but d’attirer dans des contrées presqu’inhabitées des familles dont les travaux donnèrent une plus value aux terres voisines et qui fournissaient de nouveaux éléments à l’impôt perçu, sous divers noms, sur les paysans.»
Du cantonnement des droits d’usage. Dispositions législatives.
« Le Code forestier dispose, article 63, que « le gouvernement pourra affranchir les forêts de l’État de tout droit d’usage en bois moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux» et, article 118, que les particuliers jouiront de la même manière que le gouvernement de la faculté d’affranchir leur forêts de tous droits d’usage.
«Le cantonnement est donc l’opération par laquelle le propriétaire de forêts grevées de servitudes des plus ou moins étendues, abandonne la propriété d’une partie de ces forêts aux usagers pour jouir complètement de l’autre partie
Extrait de Note du préfet des Vosges à l’Empereur Napoléon III sur le cantonnement des usagers dans les forêts domaniales des Vosges 6 juillet 1856 p192
Extrait de Annexe n°41 p 212 et 251 État des cantonnements amiables de droits d’usage réalisés dans le département des Vosges Thèse TAVELLAUniversité de Lorraine.
L’évaluation de la superficie de la forêt communale de Jésonville après cantonnement des droits d’usage dans la forêt domaniale de Saint-Christophe s’élève donc à 64,72 hectares. Jésonville, contrairement à d’autres communes ne possédaient pas de forêt communale avant ce cantonnement. Exemple de la commune de Lerrain : avant cantonnement, elle possédait 36,95 ha, le cantonnement de 1858 lui apporte 55,64 ha d’où un total de 92,59ha.
Pour Dombasle devant Darney les chiffres sont : 192,42 ha avant cantonnement, 7,22ha par le cantonnement soit 123,64 ha. Quant à Belrupt elle n’aura que 20,91 ha issus du cantonnement.
DEFINITIONS :
Cantonnement1.Opération par laquelle le propriétaire forestier abandonne en pleine propriété à des usagers une portion de ses bois, en échange de l’extinction des droits d’usage au bois précédemment exercés dans le surplus de la forêt.
2. Portion de forêt abandonnée en toute propriété à l’usager.
3. Dans son ancienne acceptation, synonyme. Aménagement règlement.
4. Circonscription administrative forestière (dénommée aujourd’hui subdivision), dirigée par un garde général.
Cens : 1.Redevance due au seigneur par les possesseurs de terres roturières comprises dans le territoire de la seigneurie.
2. Redevance annuelle en nature ou en argent payée par le titulaire d’un ascensement.
Cense : Exploitation agricole née d’un contrat d’’ascensement.